|





Cliquez sur les images ci dessous:



 HOMMAGE HOMMAGE
à Louis Jourde
décédé le 26
avril 2011
Vous êtes le
visiteur n°:

| |
E-N-T-
FAUT-IL SE MEFIER DES ENT ?
|
|
« ENT » est
l’un de ces sigles devenu familier depuis quelques temps. Dans le
secondaire, aucun enseignant désormais, ne peut l’ignorer. Il signifie :
« environnement numérique de travail ». Les « ENT » constituent donc,
premièrement, un environnement. Un environnement est un milieu qui nous
enveloppe, au sein duquel notre existence se déroule, c’est un lieu que nous
habitons. Pour l’homme, le premier de ses environnements fut la nature.
C’est aujourd’hui le monde artificiel des objets qu’il a édifié avec ses
mains. Dans ce monde artificiel où désormais il vit, l’homme a rapport avec
quantité d’objets, dont certains sont comme des prothèses qui prolongent
son corps. Au bout de la main de l’homme moderne nous trouvons par exemple
aujourd’hui, la plupart du temps, un téléphone portable. Au bout de ses
doigts nous trouvons aussi le clavier d’un ordinateur. C’est le cas pour
l’enseignant, en particulier dans le secondaire, dont la journée de travail
implique nécessairement, à un moment donné ou un autre, qu’il prenne
position en face de l’une de ces machines, quelques instants, ou plus si sa
fonction l’exige. Le support papier a été remisé, la saisie des absences est
numérisée, il n’y a plus, ou il n’y aura bientôt plus, de cahier de texte.
Les jeunes collègues ne connaîtront pas les joies du remplissage, stylo à la
main, des bulletins chaque fin de trimestre. L’outil numérique génère en
outre un espace de communication, nous n’avons plus besoin d’un contact
physique pour nous parler, on peut désormais s’échanger des informations à
tout moment, nous avons dépassé les contingences de la rencontre. Gain de
temps pour les services de la vie scolaire, possibilité de procéder à toute
une série d’opérations, confortablement, depuis chez soi, intensification
de la communication entre les enseignants, pourquoi serions-nous
nostalgiques du papier et du stylo ? Ce nouveau milieu de vie
professionnelle, cet environnement numérique de travail, pourquoi ne
serait-il pas une bonne chose ? La méfiance à leur égard, les réticences à
s’en servir, ne sont-elles pas simplement les expressions de ce réflexe
irrationnel, de cette peur qui agitent l’homme depuis toujours dès qu’il est
confronté à ses propres inventions, à ses propres prouesses techniques ? Et
d’autre part, à quoi sert de protester contre un tel progrès technique et
qui a sérieusement la prétention de l’interrompre ou de faire marche
arrière ? Qu’y-a-t-il donc à craindre dans les « ENT » ? On peut bien sûr
mentionner l’argument classique, souvent utilisé pour critiquer le progrès
technique, en particulier l’introduction de la machine dans le monde du
travail. Actuellement nous constatons au niveau de nos établissements
secondaires la baisse tout aussi spectaculaire du nombre des assistants
d’éducation dans les services de vie scolaire. Cette baisse serait-elle
possible, en tout cas dans cette dimension, si le traitement informatique
des absences, qui constitue un aspect fondamental du |
travail
quotidien des services de vie scolaire, ne permettait pas l’effectuation de
ce travail avec une main d’œuvre numériquement inférieure à celle requise
dans le contexte d’un traitement papier? Lorsque nous renseignons les « ENT »,
plutôt que de remplir comme nous le faisions il y a quelques années un
support papier, nous nous comportons, inconsciemment, comme nous nous
comportons lorsque nous remplissons informatiquement notre déclaration
d’impôts, ou comme lorsque nous passons aux caisses automatisées des
supermarchés. Nous faisons travailler des machines, et, ce faisant, nous
contribuons à rendre les fonctionnaires des impôts, les caissières de
supermarchés, ou encore les assistants d’éducation, superflus, inutiles. Si
des machines de surveillance étaient installées dans chaque couloir de
chaque établissement, peut-être la fonction d’assistant d’éducation
pourrait-elle être purement et simplement supprimée ? Il est possible que,
prenant du recul par rapport à ce fait, nous nous rendions compte qu’en
parallèle, il est compensé par un autre fait : pour la maintenance, la
conception de ces systèmes informatiques qui rendent dans certains points du
monde du travail le travailleur superflu, il faut que d’autres travailleurs
soient formés. Mais cependant, à notre niveau d’observation, ce que nous
constatons, c’est l’amaigrissement de certains postes de travailleurs, en
lien étroit avec l’installation des « ENT », et ceux-là ne seront guère
rassurés par une perspective plus globalisée. Les enseignants sont-ils à
l’abri d’être remplacés par des machines, eux dont la compétence pédagogique
ne semble guère remplaçable par des ordinateurs. Rien n’est moins sûr. Les
« ENT » en effet n’ont sans doute pas développés encore l’intégralité de
leur potentiel. Ma fille qui est en collège se connecte le soir sur les « ENT»
pour effectuer des exercices de mathématiques. Bientôt peut-être se
connectera-t-elle sur les mêmes « ENT » pour accéder à un cours qu’un
enseignant aura rédigé, ou, mieux encore, pour accéder à un cours vidéo,
qu’un enseignant réalisera en direct devant 10 classes ou plus au même
moment ? Les IFSI (institut de formation de soins infirmiers) ont
systématisé cette année le cours sous forme de vidéo conférence. Le résultat
c’est évidemment la réalisation d’un gain en termes de main d’œuvre. C’est
aussi l’élimination pure et simple de la relation pédagogique c'est-à-dire
d’un rapport individué et vivant entre l’enseignant et l’élève. Cette
relation est déjà profondément altérée dans le cadre d’un cours en
amphithéâtre, mais elle est purement et simplement détruite avec la vidéo
conférence. Cette possibilité est inscrite dans les « ENT », au titre d’un
de ses éventuels développements futurs. Pourtant ils s’imposent
insensiblement comme une évidence, dont la mise en question serait de
l’ordre d’une réaction irrationnelle. |
|
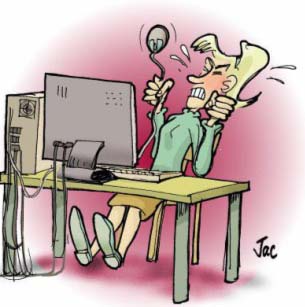
|
|
L’autre
argument que nous voudrions développer concerne une distinction qu’on trouve
chez Simondon, philosophe contemporain, bien connu pour ses réflexions sur
la technologie. Ce dernier opère donc une distinction qu’ordinairement, dans
le langage courant, on ne rencontre guère, entre l’outil et l’instrument.
L’outil, affirme-t-il, est un objet dont la mise en œuvre permet d’imprimer
certaines modifications délibérées sur le réel, permet d’accomplir certaines
actions. Par exemple, un marteau est un outil, ou encore une vis. Un
instrument est un objet qui, sans modifier le réel, permet d’en préparer la
transformation en fournissant le moyen de récolter des informations sur le
réel, de le mesurer. Par exemple un niveau de maçon permet de savoir si un
plan sensé être horizontal l’est effectivement. En
reprenant la
distinction de Simondon nous pourrions dire des « ENT » qu’ils sont à la
fois un outil et un instrument. Nous avons pourtant tendance à ne voir en
eux que des outils, outils de communication, permettant l’action de
transmettre de l’information, ou encore outils pour consigner le contenu du
cours réalisé afin de le mettre à disposition des élèves (fonction de
l’ancien cahier de classe). Mais cependant, sans que nous nous en rendions
forcément bien compte les « ENT » sont aussi un instrument : ils permettent
de récolter des informations, non dans le cadre d’une procédure de
communication explicite, mais à notre insu. Un spectateur extérieur,
disposant des accréditations requises, pourrait fort bien s’immiscer dans
nos messageries et prendre connaissance de nos conversations numériques.
Dans le cadre d’un simple échange verbal avec des collègues, une telle
démarche d’espionnage était de toute évidence plus délicate : il aurait
fallu à ce spectateur espion une complicité parmi les participants à la
conversation. Comme tout espace numérique de conversation les « ENT »
donnent l’illusion à ceux qui s’en servent pour communiquer d’être un
équivalent de l’ancienne discussion privée. Mais la possibilité de leur
accessibilité à d’éventuels espions numériques rend peu crédible ce
caractère privé auquel pourtant les utilisateurs ont tendance à croire. Les
« ENT » sont donc certes un outil de communication, mais aussi un instrument
de récolte potentiel de données dont nous croyons à tort qu’elles ne sont
accessibles qu’à nous, et à ceux avec lesquels nous voulons les partager.
Pour ma part, mes tendances paranoïaques sont sans doute responsables de
l’usage minimaliste que je fais de ma |
messagerie
électronique. Mais sans être paranoïaque on peut tout simplement être
méfiant. Aucun outil informatique de ce genre ne pourra jamais donner les
garanties nécessaires pour évacuer le risque qu’il ne devienne cet
instrument d’espionnage fournissant à ses utilisateurs les données
nécessaires à on ne sait quelle action possible. C’est ce genre de méfiance
concernant l’usage des données numériques relatives à nos espaces privés qui
environnait la mise en œuvre contestée du logiciel bases élèves.
Un autre argument
concernerait cette fois la façon dont les « ENT » transforment nos relations
professionnelles. En tant qu’alternative à la discussion verbale, ce type
d’outil numérique ne peut qu’inciter à remplacer la conversation vivante en
face à face. Or, un tel remplacement est évidemment une perte, et conduit à
l’appauvrissement de la relation à l’autre. Qu’est-ce qu’une communication
sans la parole vivante de l’autre, s’incarnant dans un visage expressif ?
Nous disons-nous autant par l’intermédiaire de nos écrans, que ce que nous
nous disons lorsque nous nous parlons ? La généralisation et
l’intensification de l’usage des « ENT » ne va-t-elle pas détruire ce qui
reste de lien vivant entre les enseignants ? C’est sans nul doute d’un
excès et donc d’un mauvais usage qu’il s’agit ici. Mais un tel excès
n’est-il pas inscrit d’une certaine manière dans l’outil numérique, dont la
puissance d’attraction est déjà bien connue : combien le célèbre dispositif
« face book » comporte-t-il aujourd’hui d’usagers ? Combien de temps chacun
de ces usagers passe-t-il devant son écran à communiquer ? Quel lien peut-il
être tissé à l’autre, via l’écran de l’ordinateur ? Ce sera toujours un lien
médiatisé, un lien indirect par conséquent. Il me semble qu’une perte du
caractère direct de la communication ne peut qu’altérer la richesse du
contact humain, et conduire à une certaine perte du rapport à l’autre, à un
certain isolement moderne, un isolement derrière l’écran. Le paradoxe de la
communication numérique est peut-être que sa généralisation isole de plus en
plus les individus. Un tel isolement, sur un plan politique est évidemment
du plus grand intérêt pour le pouvoir. Mais peut-être me reprochera-t-on
d’aller trop loin, et de céder à mes tendances paranoïaques… Ce qui est sûr
c’est que la réflexion présentée ici est loin d’être complète, et qu’elle
attend, dans les prochains numéros vos contributions qui seront donc les
bienvenues sur cette question.
Franck
Lacrampe
|
|

